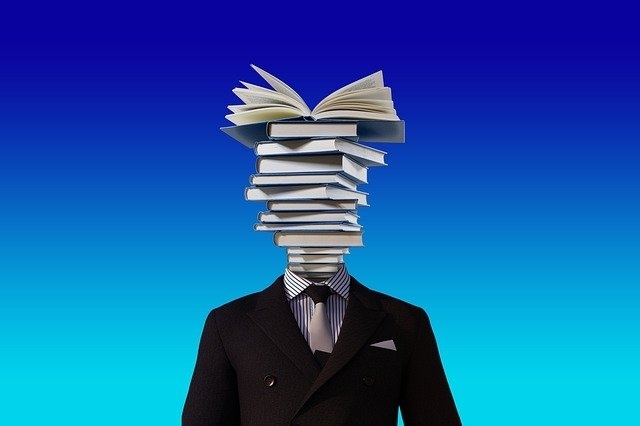Bien évidemment, elles ne sont pas toutes là!
Découvrez les plus belles perles du bac 2022
Comme chaque année, certains élèves se sont ainsi surpassés de manière insolite, soit par méconnaissance ou défauts de compréhension, soit par simple manque de relecture. Entre les lapsus improbables, les contresens qui induisent en erreur, mais aussi les réflexions personnelles discutables ou encore les hors-sujets rédhibitoires, il y en a pour tous les goûts dans les copies. Une sélection à la fois savoureuse et - il faut bien le dire - quelque peu consternante.
SERIES TECHNOLOGIQUES
Les deux sujets de dissertations de philosophie, proposés aux candidats des séries technologiques, en ont manifestement inspiré plus d'un, pour le meilleur et surtout pour le pire. Ainsi à la question "La liberté consiste-t-elle à n’obéir à personne?", un élève a choisi de répondre avec une audacieuse analogie -mais il aurait peut-être été préférable qu'il s'abstienne.
"Par exemple, si je dis je refuse de prendre ce sujet de philosophie au surveillant qui me le donne, c’est que je suis libre de ne pas faire ce bac philo parce que j’en ai pas envie. Mais je suis raisonnable, alors je le fais, mais je perds ma liberté", a-t-il ainsi écrit, comme le révèle le Parisien. Imparable n'est-ce pas?
L'un de ses camarades a préféré, lui, reprendre une célèbre devise pour illustrer son propos. Seulement voilà, ce dernier s'est rendu coupable d'une toute petite faute de rien du tout qui, hélas, change légèrement le sens de sa phrase, comme vous pouvez le constater. "Comme disaient les anarchistes: ‘ni dieu ni mètre’". Chacun aura évidemment rectifié.
Le second sujet de dissertation demandait aux élèves s'il est juste de défendre ses droits par tous les moyens? Pour répondre, l'un des candidats épinglés a fait allusion à des événements récents, non sans un certain humour et avec un sens particulier de l'analyse. "Des gilets jaunes ont perdu un œil pour leur défendre leur droit, mais il n’ont pas pu faire ‘œil pour œil’ car les CRS avaient des casques ", écrit en effet l'intéressé.
Un autre lycéen a quant à lui fait le choix de manier le proverbe mais un lapsus - sûrement révélateur - a donné à son argumentaire une tournure assez comique: "La faim justifie les moyens".
Enfin, l'une des explications de texte consacrée à une œuvre de Diderot a fait naître une profonde réflexion philosophique chez l'un des candidats. Jugez plutôt: "Si je vois un éléphant rose et que mon voisin voit un éléphant gris, c’est qu’il y a un problème chez lui ou chez moi". C'est pas faux, comme dirait un certain... Perceval!
SERIES GENERALES
Les séries générales ne sont pas en reste et de nombreuses pépites sont à signaler. Illustration avec la copie de philosophie de ce lycéen qui a écrit que "Bétowen s’est livré à de bonnes pratiques artistiques", en réponse au sujet "les pratiques artistiques transforment-elles le monde?".
Une élève nous explique, quant à elle, que "le maquillage est de l’art car dans l’émission ‘incroyable transformation’ la maquilleuse transforme le look des personnes moches".
Deux autres candidats nous apprennent par ailleurs que "certaines rock stars, quand elles chantent ou crient, on dirait qu’elles jouissent", ou encore que "les artistes (ils) remuent la terre".
Concernant le second sujet de philosophie ("Revient-il à l’État de décider de ce qui est juste?" ndlr), les deux réflexions ci-dessous ont particulièrement retenu notre attention:
- "Si le président Macron décide quelque chose, c’est que c’est forcément juste, puisque c’est le président".
- "Si je trouve juste de rompre avec ma petite amie parce qu’elle est agaçante et que je ne veux plus la subir, c’est à moi de décider, pas au juge".
Quant aux jolies perles repérées dans les commentaires composés, les deux suivantes nous ont beaucoup fait rire, sans méchanceté aucune, bien sûr.
- "La spychologie permet de mettre de l’ordre dans la tête"
- "On sait très bien que l’univers a été créé par le big band".
D’autres curiosités ont été recensées dans les copies, notamment par le magazine Marie France qui nous rapporte par exemple qu'un candidat a écrit, le plus sérieusement du monde, que "le gouvernement de Vichy siégeait à Bordeaux". Logique!
Un autre élève a livré une définition pour le moins étonnante d'une croisade (on ne vous cache pas que c'est notre préférée) en expliquant qu'il s'agit d'un "voyage en bateau organisé par le pape".
Une candidate a également affirmé que "la danse typique de l’Argentine" était "la paëlla". Les amateurs de tango apprécieront...
Enfin, certains élèves, visiblement en délicatesse avec la géographie, ont répondu que la capitale de l'Espagne était "Mexico" ou... "Argentina"!