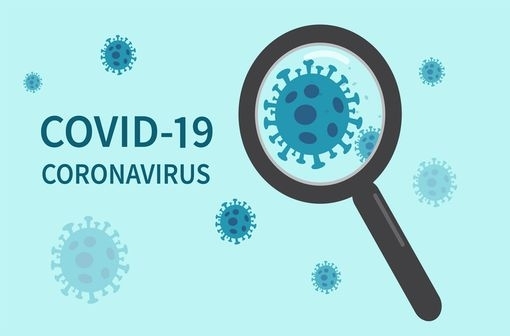Origine de la viande: la fin très discrète de l’étiquetage obligatoire
Les éleveurs français s’inquiètent de la place prise par les importations, souvent de pays dont les standards de qualité ou de bien-être animal sont moins élevés.
Un voile d’opacité est-il en train de s’abattre sur les rayons de nos supermarchés? Les cordons-bleus, jambons crus, cassoulets en conserve, pizzas, sandwichs au jambon préemballés… Bref, tous les produits transformés sont débarrassés d’une contrainte depuis le début de l’année : celle d’indiquer l’origine de la viande qu’ils contiennent.
Cette obligation de transparence aura duré cinq ans. Elle avait été instaurée début 2017, peu de temps après la fameuse affaire des lasagnes à la viande de cheval. À l’époque, cette fraude d’ampleur avait révélé les zones d’ombre de certains circuits d’approvisionnement de l’industrie agroalimentaire : après être passé dans les mains d’un trader néerlandais, du cheval roumain avait été revendu comme du bœuf… La falsification avait touché des lasagnes de marque Findus mais aussi, on s’en souvient moins, des dizaines d’autres références de produits (couscous, moussaka, hachis parmentier, raviolis…) de grandes marques comme de celles de distributeurs.
Consommateurs et éleveurs déplorent ce recul réglementaire
La mention de l’origine fait aujourd’hui les frais d’une réglementation européenne défavorable. Elle n’était en vigueur en France qu’à titre “expérimental”. Et c’est l’expérimentation autorisée par Bruxelles qui a pris fin en catimini le 31 décembre dernier.
Elle bénéficiait pourtant du soutien des associations de consommateurs comme des éleveurs. “Les consommateurs ont soif de transparence sur la manière dont sont fabriqués les aliments transformés, autant sur leur recette que sur l’origine des ingrédients”, assure Olivier Andrault, chargé de mission alimentation à l’UFC-Que Choisir. Les représentants des différentes filières (boeuf, porc, volaille) contactés par L’Express déplorent aussi ce recul réglementaire.
(…)