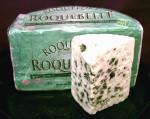La charcuterie fumée vous tue!
Mon ami Yoshi aime bien la charcuterie fumée qu'il rajoute dans sa recette de choucroute, la seule entorse faite aux plats du sud-ouest (qu'il affectionne beaucoup, et je veille au grain!!!). Il habite à Yokohama et il a beaucoup de mérite de vouloir manger de nos produits locaux, au prix où il les trouve au Japon. Cette note est pour lui mais aussi pour vous tous: attention, danger des charcuteries et poisson fumés!
Cela fait des années que je suis au courant du fumage bidon des charcuteries ou du saumon; le goût du fumé, je me le fabrique en faisant bien roussir des oignons, comme j'ai déjà indiqué dans toutes mes notes…. mais, comme je suis dans ma phase senior, je sais bien que les oignons bien roussi ne sont plus bons pour moi… et oui, au bout de quelques années, il faut faire attention aux grillades sur le feu de bois et aux viandes et autres pomme de terre et légumes trop grillés. J'ai appris en lisant énormément de publications diététiques… et d'ailleurs, l'Agence de Sécurité Alimentaire a informé les industriel du risque de santé publique à cause de l'acrylamide dégagé par les produits cuisinés vendus au public.
Pour les fêtes, j'achète toujours du saumon fumé au bois de hêtre, uniquement. Et toujours, c'est du saumon Label Rouge…. le plus cher est le meilleur pour ma santé. Vous, vous faites comme vous voulez …. ou vous pouvez… mais, lisez bien tout et vous m'en dirait des nouvelles!!!! J
La grande majorité des produits fumés vendus en France le sont grâce à un procédé particulier qui fait appel à de la fumée liquide fabriquée avec du “chimique“.
Normalement, si sur l'emballage du produit c'est noté "fumé au bois de hêtre", c'est vrai: ça suppose un fumoir-séchoir, on met le feu en bas, ça fume évidemment en fonction de la température du feu, au dessus on a installé des claies, la fumée passe dedans et atteint "l'aliment" à fumer déposé sur les claies, et ça fume par imprégnation de surface. L'opération dure plusieurs jours: hic. Et cata, le bois ça coûte, alors que l'arôme industriel, fabriqué en milliers de tonnes, ça coûte bien moins cher.
D'habitude, la fumée est gazeuse, et n'est pas bénéfique pour nous, (rappelons-nous tout le foin fait pas la mairasse de Paris qui voulait interdire les feux de cheminées!) mais quid d'une fumée liquide? C'est encore un nouveau truc ça, des toqués de la toque: pour eux, il est bon pour nôtre goût de manger de la fumée!
Savez-vous que c'est nocif, la fumée liquide, et plus particulièrement cancérigène?
Il y a quelques décennies (1982), on a testé la cancérogénicité de ces produits sur des bactéries: on voulait déterminer si les fumées liquides provoquaient des mutations sur l'ADN. Ceci en regardant le taux de mutations chez Salmonella Typhimurium: le test a été négatif. Même en ajoutant de plus en plus de fumée liquide (composés phénoliques) le test demeure négatif. Mais le fait que quelque chose ne soit pas mutagène chez une bactérie ne prédit pas l'effet possible sur des cellules humaines, non? à votre avis?
Un groupe du MIT a donc testé l'hypothèse sur 2 types de globules blancs humains avec une fumée liquide (de hickory: c'est du noyer et non pas du hêtre comme on en a l'habitude en France) achetée à l'épicerie du coin. Contrairement à la bactérie, le taux de mutations a grimpé, mais il y a peu de preuves qu'il y ait des risques pour la santé humaine. Les mutations obtenues dans une boite au laboratoire ne veulent pas dire que la même chose se produit dans le corps humain.
Endommager l'ADN est juste une des multiples façons dont les produits chimiques peuvent être toxiques pour nos cellules.
10 ans plus tard, les chercheurs ont testé l'effet global de la fumée liquide sur la viabilité des cellules. Si vous mettez de l'eau sur les cellules, rien ne se passe… sauf pour l'eau de Lourdes!... mais, inutile de se perdre dans les miracles…
Si on lui ajoute du liquide de fumée de feu de bois, la survie commence à baisser. La fumée de cigarette tue encore un peu plus, mais 3 marques de fumée liquide sur les 4 achetées tuent encore plus.... que la fumée de tabac. Or les investigateurs de l'étude étaient employés par l'industrie du tabac (R.J.Reynolds)!
Rassurez-vous, braves gens, on veille sur nous: la preuve.
D'après le laboratoire DGCCRF de Massy
"Les arômes de fumées sont des produits extraits de fumées mis ou destinés à être mis en œuvre dans ou sur les denrées alimentaires pour leur conférer un goût et/ou une odeur "fumé" conformément à la définition réglementaire des arômes alimentaires"
On peut considérer qu’un arôme de fumée correspond à des produits extraits de la fumée, mis et appliqués sur des denrées alimentaires, pour leur procurer un goût ou une odeur de fumée, conformément à la définition réglementaire des arômes alimentaires.
Les arômes de fumée sont encadrés par le règlement 2065/2003 relatif aux arômes de fumée, qui définit deux types de produit d’arôme de fumée. On appelle produits primaires de fumée, les produits qui sont issus de la condensation de la fumée. On distingue ensuite les arômes de fumée dérivés qui sont des produits issus du traitement physique des produits primaires visés, l’ensemble ci-dessus étant dénommé "arômes de fumée".
Comment en pratique obtient-on un arôme de fumée? C’est tout à fait naturel: vous prenez du bois que vous faites brûler, mais pas n’importe quel bois. Vous le faites brûler – bien entendu ce bois n’a pas été traité – et vous faites une combustion contrôlée en général en dessous de 600 °C.
La fumée liquide est réalisée (avec des “Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques“). La fumée est condensée pour obtenir un jus noir. Vous avez donc 3 phases: la première phase est une phase huileuse qui est totalement insoluble dans l’eau. Il est hors de question de l’utiliser comme un arôme et bien évidemment de l’utiliser sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. Vous allez obtenir aussi un condensat de fumée primaire qui est une phase aqueuse. C’est une fumée liquide. Ce terme est beaucoup utilisé au laboratoire. C’est un jus complètement noir avec une odeur de fumée très caractéristique. Vous avez enfin des fractions de goudron primaire. Ce sont des restes. Ces deux derniers produits sont des produits primaires de fumée qui ensuite peuvent devenir des arômes de fumée par traitement annexe.
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques? et c'est quoi? c'est une grande famille où existent plusieurs acteurs, le principal étant le benzo(a)pyrène, reconnu le plus toxique par des études scientifiques. Cette molécule a été classée en 2A, donc cancérigène chez l’animal et potentiellement cancérigène chez l’homme. Nous n’avons pas de preuve et évidemment il n’existe pas d’étude épidémiologique. Parmi les molécules cycliques aromatiques, le benzo(a)pyrène est très connu et est dangereux.
Petite liste d'arome que permet la France
Pour ceux que cela intéresse, les produits fumés traditionnellement. Les produits aromatisés relèvent du règlement 2065/2003. Les produits fumés traditionnellement relèvent eux du règlement 466/2001 qui a été modifié.
LES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
Benzo(a)pyrène
Benzo(a)Anthracène
Cyclopenta(c,d)pyrène
dibenzo(a,e)pyrène
dibenzo(a,i)pyrène
dibenzo(a,h)pyrène
Chrysène
5-méthylchrysène
Benzo(b)Fluoranthène
Benzo(j)Fluoranthène
Benzo(k)Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
diBenzo(a,h)Anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
dibenzo(a,l)pyrène
D'après une autre nouvelle étude, la réponse aux produits testés était mesurée par le degré d'activation de la protéine p53.
P53 est une protéine que nous fabriquons, et qui s'attache à notre ADN. Celle-ci active les enzymes de réparation de l'ADN. Ainsi, une forte réponse d'activation de p53 pourrait signifier qu'il existe beaucoup de dégâts sur l'ADN. Et quelques marques de fumées ont déclenché l'activation de la p53, presque autant qu'un agent de chimiothérapie anti cancéreuse, l'étoposide (celltop, étoposide, vépéside en France ; ce médicament inhibe la topo-isomérase II, en fait détruit les brins d'ADN), de même une marque de sauce de poisson. La fumée liquide de paprika n'a produit aucune modification.
La propriété d'activation de la p53 était éliminée par la cuisson standard pendant 1 heure à 175 °C. Donc, si nous cuisons quelque chose avec de la fumée liquide assez longtemps, cet effet devrait être éliminé, mais simplement une cuisson vapeur, ou mijotage, ou même bouillie pendant une heure ne semble pas fonctionner. Les auteurs concluent que si l'activité d'endommagement de l'ADN des fumées liquides était néfaste, il serait possible de la remplacer par d'autres substances de fumées plus sécuritaires.
Pourquoi disent-ils "si l'activité..." était dommageable? C'est parce que l'on ne mesure pas directement les dégâts de l'ADN, mais l'activité de la p53. Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. P53 est considérée comme un défenseur du génome, un suppresseur de tumeur. Si quelque chose augmente son activité, est-ce bon ou pas?
C'est comme l'histoire du brocoli. Les crucifères augmentent très fortement l'activité des enzymes de détoxication du foie: est-ce parce que le corps considère le brocoli comme très toxique et tente de s'en défaire rapidement? Peu importe, car le brocoli diminue le risque de cancer in fine. C'est un phénomène biologique connu sous le nom d'hormèse: en somme, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort (c'est aussi un message de Nietzsche!)
Une faible dose de poison a l'effet inverse d'une forte dose.
Tout comme l'exercice physique qui représente un stress pour l'organisme, mais qui en "quantité" adéquate est bénéfique à la longue. Les thés et les cafés activent également la p53, mais leur consommation est associée à une diminution du risque de cancer. Il est donc difficile de savoir quoi penser avec les résultats obtenus avec les fumées liquides et la protéine p53.
En raison des tests utilisés actuellement, il est difficile de se faire une idée du potentiel génotoxique de divers produits. Une meilleure approche serait d'analyser les fumées liquides pour certains carcinogènes connus, des produits chimiques que nous connaissons pour causer des cancers. Comme on dit, chez nous, dans le doute… abstient-toi.
Dans ma région, je n'ai jamais entendu parler de charcuterie fumée…. Sans doute nos ancêtres de Midi-Pyrénées avaient confusément compris que fumer la charcuterie n'était pas bon pour la santé?….
Est-ce une des composantes du French Paradox