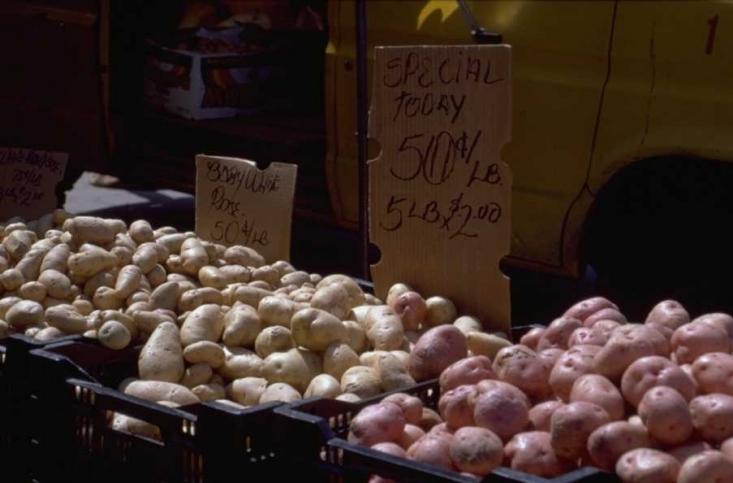Le pauvre, il est accusé de tous les maux: trop calorique, trop gras, trop riche en mauvais acides gras…
Le beurre n’est pas nouveau dans l’alimentation de l’homme qui en mange depuis… plus de 4500 ans. Il est préparé à partir de la crème du lait. Il faut 20 litres de lait pour fabriquer 1 kg de beurre.
Bien que fabriqué à partir du lait, le beurre ne fait pas partie du groupe des produits laitiers car il est dépourvu de calcium. Il appartient au groupe des matières grasses au même titre que la margarine, la crème fraîche et l'huile.
Le beurre: sa richesse en vitamine A
La vitamine A est un anti-oxydant qui joue un rôle important dans :
- la vision crépusculaire: adaptation à l'obscurité,
- le maintien en bon état de la peau et des muqueuses, en favorisant notamment la sécrétion de mucus, le renouvellement des couches externes de la peau,
- la prévention des cancers de la peau,
- la croissance osseuse et la synthèse de certaines hormones telle la progestérone,
- la lutte anti-infectieuse et immunitaire...
Une carence en vitamine A entraîne, à long terme, une dégradation de l’état général avec une plus grande susceptibilité aux infections virales, un vieillissement de la peau avec apparition prématurée des rides.
Les besoins en vitamine A sont estimés à 600 µg pour la femme et 800 µg pour l’homme. Il fait partie des aliments les plus riches en vitamine A, après le foie (aux 100 g), mais il est utile de comparer cet apport avec d’autres aliments
Apport en vitamine A d'autres aliments qui en sont les plus riches :
- 1 noix de 10 g de beurre: 76 µg,
- 1 tranche de 120 g de foie: 12000 à 18000 µg,
- 1 œuf: 550 µg,
- 1 verre de 200 ml de lait entier: 80 µg (contre 40 µg pour le lait demi-écrémé et 0 µg pour le lait écrémé),
- 1 portion de 30 g de camembert: 82 µg.
Pourtant, quel bonheur enfantin de mettre du bon beurre frais sur une tartine de très bon pain croustillant! J'adore: énorme, beaucoup!
J'ai vu récemment un documentaire sur la 5 qui parlait du beurre: il avertissait des incroyables manipulations de l'industrie agro-alimentaires. Vous n'avez même pas idée!
D'ailleurs, cela faisait frémir.... à dégoûter des plaquettes de tous poils!
En conclusion, le journaliste disait que le meilleur beurre était celui qui était marqué AOP, moulé à la louche. Même le bio est plus ou moins trafiqué. Donc à exclure.
Perso, depuis un an et demi, j'achète donc du beurre AOP, moulé à la louche.
Si, à force de couper du beurre, le papier se déchire, faites comme moi: j'ai récupéré l'emballage de tablettes de chocolat achetées chez Lidel… cela me permets de re-emballer le beurre lorsque son papier est détérioré.
Il faut dire que nous n'en utilisons qu'assez peu et pour que la tablette se conserve bien après la date indiquée sur l'emballage, ce papier chocolat est parfait. Il faut emballer soigneusement le morceau de beurre, éviter qu'il soit en contact avec l'air, le mettre dans une boîte à beurre, tant pis si elle est en plastique, et conserver au réfrigérateur; je le glisse sur la clayère la plus basse. N'emballez pas votre beurre côté extérieur du papier du chocolat.
Bien sûr, il n'est pas tartinable dès la sortie du réfrigérateur, donc, le sortir une demi-heure minimum avant usage sur tartines.