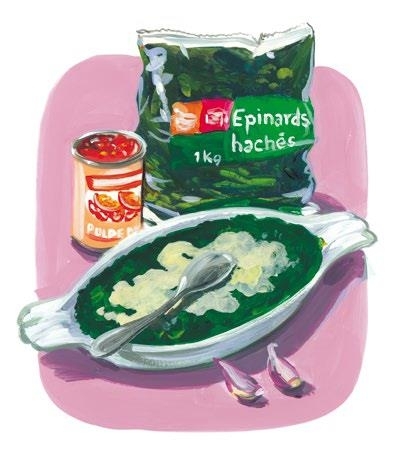… à condition de ne pas jeter l'huile qui contient les oméga-3.
Le foie de la morue est mis directement en boîte; il es très gras et perd son huile… c'est pour cela que vous le trouvez avec beaucoup d'huile mais, c'est elle qu'il faut avaler! (je dirai même qu'il faut jeter le foie et garder l'huile… mais, bon, le foie posé sur des biscottes ou petits pains grillés, un délice…).
Le foie de morue apporte 188 µg/100 g de vitamine B9 (vitamine obligatoire pour les femmes enceintes).
C’est aussi une bonne source de vitamines A (les yeux) et D (rachitisme, santé des os) ainsi que des oméga-3.
Voici mes conseils pour votre boîte de foie de morue, que vous trouvez en boutique au rayon sardines. Si la boîte est sale, n'hésitez pas à la laver sous l'eau avant ouverture.
Après avoir ouvert la boîte (en pestant contre les nouveaux systèmes d'ouverture qui, toujours, se cassent et vous obligent à prendre un ancien ouvre-boîte, mettant ainsi de l'huile partout sur l'évier), passez tout ce qu'elle contient dans une passoire très fine.
Retirez le foie, à consommer sur du pain ou dans les préparations ci-après. Il faut séparer l'huile du foie (sauf utilisation dans les pâtes ou le riz). Le foie de morue se consomme tel quel nature ou mélangé aux aliments chauds ou froids (voir plus bas).
Conservez l'huile dans une bouteille ou un pot en verre à vis. Il faut filtrer très finement pour retirer la moindre miette du foie: ainsi, vous pouvez conserver longtemps votre huile d'oméga-3… bien sûr, plus le temps passe, plus l'huile s'oxyde en odeur… de poisson.
PATES, RIZ, BLE, QUINOA en salade tiède ou froide
Faites cuire normalement les pates, le riz, le quinoa et le blé dans de l'eau bouillante salé; passez pour retirer l'eau puis mettre dans un saladier. Arrosez de très bon vinaigre et de l'huile récupérée du foie de morue.
Rajoutez des miettes de thon AU NATUREL bien sûr, puisque vous rajoutez l'huile de foie de morue conservée et/ou conserve en verre de moules ou maquereaux au vin blanc (vous avez compris qu'avec l'huile de foie de morue qui nouvelle ouverte sent un peu le poisson. bien sûr, plus le temps passe, plus l'huile s'oxyde en odeur… de poisson.
Petits oignons blancs, câpres, cornichons, etc… Vous consommez froid ou tiède.
Rajoutez le foie récupéré dans une salade de tomates, betteraves ou carottes râpé etc… mais vous n'êtes pas obligé-e de rajouter des éléments de la mer, le foie suffit souvent.
Pour les sardines en boîte, c'est pareil: les omégas sont dans l'huile de la boîte quelle que soit l'huile utilisée pour la conserve, mais ne soyez pas bêtes: prenez uniquement des sardines à l'huile d'olive. Surtout si vous gardez les boîtes plusieurs années. Jouez la qualité, toujours. Achetez des sardines en boîte des très grands marques de conserveurs: en effet, si vous achetez des boîtes dites Label Rouge, vous aurez la certitude que les sardines sont de pêches fraîche. Sinon, étant donné qu'en France on ne pêche plus guère la sardine (un peu disparue de nos côtes) les conserveurs “généralistes“ utilisent des sardines surgelées pêchées par des étrangers.
En France, on fait travailler les Français… on n'engraissent pas les autres!
Dommage, hélas, que les sardines soient en boîte bisphénolées…